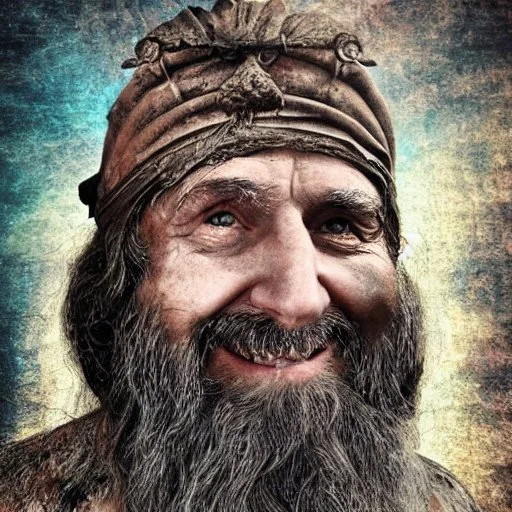L’Afrique du Sud, cheffe de file de l’offensive diplomatique du « Sud global »
Guerre Israël-Hamas, invasion russe de l’Ukraine, injustice climatique, pandémie de Covid-19… Pretoria a pris la tête d’un groupe de pays qui rejettent la lecture occidentale des événements du monde, et qui veulent avoir voix au chapitre.
Par Sarah Diffalah · Publié le 2 février 2024 à 10h00 · Mis à jour le 2 février 2024 à 13h43
Dès leur arrivée à l’aéroport de Johannesbourg, de retour de La Haye, les membres de l’équipe juridique sud-africaine ont été accueillis comme des rock stars, et salués en héros. Les plaidoiries des avocats qui ont soutenu devant la Cour internationale de Justice (CIJ), le 11 janvier, qu’Israël avait violé ses obligations au titre de la Convention sur le génocide, dans sa guerre contre le Hamas à Gaza, ont fait le tour du monde. « Nous sommes tous devenus sud-africains » , titrait alors le site de la chaîne qatarie Al-Jazeera. Le 26 janvier, lors de son audience, la plus haute juridiction de l’ONU a donné raison à Pretoria sur le fondement de sa plainte, estimant qu’il existait un « risque réel et imminent » pour les droits des Palestiniens, dont celui d’être protégé contre le génocide. Réuni avec les ministres pour écouter cette décision historique, le président sud-africain Cyril Ramaphosa, keffieh autour du cou comme presque tous les participants, s’est levé, souriant, et a pris dans ses bras plusieurs ténors du gouvernement. La salle s’est ensuite mise à danser et à chanter.
Pour beaucoup, Pretoria a eu le courage que personne d’autre n’a eu, malgré les plus de 26 000 personnes tuées dans les bombardements israéliens sur Gaza et le déplacement forcé de 80 % de ses habitants, de poursuivre I’Etat hébreu devant un tribunal international. Beaucoup reprochent aux grandes puissances occidentales leur manque d’action pour empêcher les pertes en vies humaines, et leur double standard en matière de droit international. De nombreux pays, essentiellement du Sud (la Bolivie, le Brésil, le Chili, la Turquie, la Malaisie, la Jordanie et les pays de l’Organisation de la Coopération islamique) ont soutenu la requête de Pretoria. En brandissant l’arme du droit, l’Afrique du Sud s’est positionnée en arbitre moral de la question israélo-palestinienne.
En face, les réactions des pays du Nord ont été mitigées. Alors que certains ont maintenu une position diplomatique prudente, d’autres, en particulier les alliés les plus fidèles d’Israël, ont critiqué la plainte déposée fin décembre par l’Afrique du Sud. L’administration Biden a ainsi réfuté l’accusation de génocide, la qualifiant de « sans fondement », tandis que l’Union européenne s’est refusée à tout commentaire. La saisie de la CIJ par Pretoria a mis en lumière, une fois de plus, la fracture entre les pays occidentaux et ce qu’on appelle le « Sud global » - un concept complexe qui permet de regrouper, pour faire simple, les pays caractérisés par des niveaux de revenus plus faibles, des économies en développement et qui, historiquement, ont été relégués en marge de l’ordre mondial.
Crime de guerre ? Crime contre l’humanité ? Génocide ? De quoi Israël pourrait être accusé par la justice internationale
La plainte de l’Afrique du Sud, dont l’histoire a été marquée par la lutte contre l’apartheid, a eu un écho symbolique fort auprès des pays marginalisés par la mondialisation et le capitalisme, dont beaucoup ont été confrontés au fardeau de l’oppression et du colonialisme. La cause palestinienne est au coeur de l’identité politique du Congrès national africain (ANC), le parti historique au pouvoir. Une proximité née dans les années 1960-1970, lorsque Israël entretenait des relations ambiguës avec le régime de la minorité blanche. Par solidarité avec les peuples du tiers-monde, Nelson Mandela, icône du mouvement anti-apartheid, était un fervent partisan de l’Organisation de Libération de la Palestine (OLP) et de son leader Yasser Arafat. Les deux mouvements se sont mutuellement soutenus, tant financièrement que militairement. Arafat fut l’un des premiers dirigeants que Mandela rencontra après sa sortie de prison le 11 février 1990. « Nous ne savons que trop bien que notre liberté est incomplète sans celle des Palestiniens », déclarait Mandela en 1997, trois ans après être devenu le premier président démocratiquement élu de son pays. Des mots célèbres, et qui résonnent aujourd’hui encore dans les rues sud-africaines lors des manifestations pour un cessez-le-feu.
L’attaque sans précédent du Hamas contre Israël, qui a fait quelque 1 140 morts, dont deux ressortissants sud-africains (un autre a été pris en otage), n’a pas changé la position du parti au pouvoir. Bien qu’il ait condamné l’attaque, Cyril Ramaphosa a promis la solidarité de l’ANC avec les Palestiniens, affirmant que leur histoire faisait écho à la lutte de l’Afrique du Sud. La ministre des Affaires étrangères, Naledi Pandor, a reproché aux pays occidentaux d’avoir condamné sélectivement l’invasion de l’Ukraine par la Russie tout en ignorant l’occupation israélienne des territoires palestiniens. La même Naledi Pandor avait été particulièrement critiquée pour avoir eu une conversation téléphonique avec le chef du Hamas, Ismaël Haniyeh, quelques jours seulement après le 7 octobre. « L’Afrique du Sud s’est toujours efforcée de trouver des solutions et de promouvoir la paix. Lorsque les dirigeants du Hamas ont demandé à me parler, j’ai accepté et j’ai transmis le souhait de l’Afrique du Sud qu’il y ait la paix. C’est ma responsabilité de le faire. Lorsque l’Etat de l’apartheid a voulu parler à nos dirigeants, nous n’avons pas dit : “Ils nous ont fait du mal, ils ont emprisonné nos pères et nos grands-pères.” Nous avons dit : “Parlons.” C’est le caractère sud-africain » , avait-elle justifié.
« Apartheid vaccinal »
La position de l’Afrique du Sud s’inscrit donc dans la continuité de ses sympathies propalestiniennes, dont elle a fait un fondement de sa politique étrangère. Le ralliement d’une partie du monde à ce soutien a souligné des frustrations plus profondes des pays du Sud. En intentant une action pour génocide contre Israël, l’Afrique du Sud ne s’est pas contentée de traduire en justice le gouvernement israélien, elle a remis en cause l’ordre issu de la Seconde Guerre mondiale et dominé par l’Occident. « Pour les Sud-Africains, un ordre mondial ne serait pas un retour à la bipolarité de la guerre froide, ni à l’unipolarité de l’après-guerre froide, lorsqu’ils ont vu l’Otan contourner l’Union africaine et intervenir en Libye en 2011 contre leur gré. Ils aimeraient voir émerger de multiples centres de pouvoir dans un système qui offre davantage de liberté d’action aux pays en développement les moins puissants » , écrivent plusieurs chercheurs de la Fondation Carnegie pour la Paix internationale.
La succession de crises qui ont affecté les pays du Sud a accentué la défiance, donnant à Pretoria l’occasion de se positionner comme chef de file de ceux qui veulent avoir voix au chapitre dans les affaires mondiales. Malgré des divergences de valeurs et des traditions politiques différentes, ces pays du « Sud global » ont un intérêt commun à remettre en cause la hiérarchie du système international. L’Afrique du Sud, pays le plus industrialisé du continent, s’est fait remarquer lors de la pandémie mondiale de Covid-19. Cyril Ramaphosa avait dénoncé l’accaparement des vaccins par les pays du Nord, parlant d’un « apartheid vaccinal », et demandé la levée des brevets sur leur production. Les nations africaines ont eu « l’impression d’être des mendiantes quand elles ont eu besoin d’avoir accès aux vaccins » , a-t-il également dit en juin, lors du Sommet pour un nouveau pacte financier mondial à Paris.
« La manière dont la réponse militaire d’Israël s’organise pose problème du point de vue du droit international, c’est confirmé par la plus haute cour mondiale »
Le changement climatique n’échappe pas à cette logique. Si l’Afrique du Sud, premier pays émetteur de gaz à effet de serre du continent - treizième dans le monde - a été le premier pays en développement à conclure, en novembre 2021, un partenariat pour une transition énergétique juste avec la France, l’Allemagne, le Royaume-Uni, l’Union européenne et les Etats-Unis, il attend davantage de solidarité internationale pour l’aider à décarboner son économie sans pénaliser son développement.
« Non-alignement »
Mais c’est à propos de la guerre en Ukraine que Pretoria a provoqué des remous, y compris en interne. Le gouvernement sud-africain, qui décrit sa position comme « non alignée », s’est abstenu sur toutes les résolutions relatives à l’Ukraine adoptées à l’Assemblée générale des Nations Unies. Cyril Ramaphosa a estimé que même si son pays ne pouvait pas « tolérer le recours à la force et la violation du droit international » , il n’adopterait pas « une position très antagoniste à l’égard de la Russie » .
En mai, l’ambassadeur américain Reuben Brigety a accusé Pretoria, sans présenter d’éléments tangibles, de fournir des armes au Kremlin. Le comité d’enquête indépendant, présidé par un juge à la retraite et désigné par la présidence, a conclu qu’aucune preuve d’un tel transfert n’existait. Ce soutien présumé a donné lieu à une querelle ouverte avec les Etats-Unis. Washington, deuxième partenaire commercial de Pretoria après Pékin, a menacé d’exclure l’Afrique du Sud d’un important accord. L’affaire fait suite à l’accueil en février des marines russes et chinoises pour des exercices au large de sa côte est. La ministre des Affaires étrangères a balayé les critiques, estimant que « tous les pays mènent des exercices militaires avec des amis du monde entier » .
C’est également au nom de ce « non-alignement » que, lors du 15 sommet des Brics (Chine, Russie, Inde, Brésil et Afrique du Sud) accueilli par l’Afrique du Sud en août 2023, les autorités sud-africaines ont demandé - en vain - une dérogation au mandat d’arrêt de la Cour pénale internationale contre Vladimir Poutine. Le président russe a finalement décidé de participer en visioconférence au rendez-vous, mettant fin à l’embarras de Cyril Ramaphosa. Pour dissiper les soupçons persistants de soutien à la Russie et étayer ses déclarations de « neutralité », Cyril Ramaphosa a mené en juin une mission de paix africaine à Kiev.
Une voix au sein des Brics
L’ANC entretient des liens avec Moscou qui remontent à la guerre froide, lorsque l’Union soviétique soutenait sa lutte contre l’apartheid, et que Washington avait non seulement désigné l’ANC comme organisation terroriste, mais également refusé d’imposer des sanctions contre le gouvernement de Pretoria jusqu’en 1986. La plupart des dirigeants sud-africains, notamment Thabo Mbeki, se sont formés à l’université Lumumba à Moscou. Cette relation amicale ancienne peut expliquer la volonté de Pretoria de ménager la Russie.
Mais au-delà des liens historiques, c’est son adhésion aux Brics - qui représentent désormais près du tiers du PIB mondial et près de la moitié de la population - qui pousse sans doute l’Afrique du Sud à conserver de bonnes relations avec ses partenaires et à rester dans le « camp » des pays émergents. Pretoria aurait certes fort à perdre d’une brouille avec les Etats-Unis et l’Union européenne, avec lesquels elle entretient des relations commerciales bien plus substantielles qu’avec la Russie. Et avec moins de 2 % de la population des Brics et moins de 2 % du PIB du groupe, il affiche des indicateurs économiques loin derrière ceux de ses partenaires. C’est donc grâce à sa stature diplomatique que le pays parvient à conserver une voix au sein du bloc : il a siégé à plusieurs reprises au sein du Conseil de Sécurité de l’ONU en tant que membre non permanent, a présidé l’Union africaine, et est représenté au G20 qu’il accueillera en 2025.
Sur la scène internationale, ni Washington ni Bruxelles ne peuvent se permettre de s’aliéner le poids lourd industriel et diplomatique du continent africain, à l’heure où la Russie et la Chine gagnent du terrain. Lors de sa tournée africaine fin janvier, le secrétaire d’Etat américain Antony Blinken a d’ailleurs tenu à assurer que, malgré les désaccords sur la plainte sud-africaine à la CIJ, la coopération entre Washington et Pretoria ne serait pas affectée.
Loin de l’héritage de Mandela
La politique étrangère de Cyril Ramaphosa divise les Sud-Africains, appelés à voter cette année lors d’élections générales qui s’annoncent particulièrement difficiles pour le parti de Nelson Mandela, au plus bas dans les sondages. En raison des opinions passionnées des deux côtés, certaines stations de radio ont délibérément limité le temps d’antenne des appels d’auditeurs désireux de discuter de la guerre entre Israël et le Hamas. Une responsable de l’ANC, Gabriella Farber, a démissionné du parti, l’accusant de « soutenir le Hamas ». « On m’a clairement fait comprendre qu’il n’y a pas de place à l’ANC pour une juive fière de l’être » , a-t-elle déclaré dans sa lettre de démission publiée sur X.
Gaza : « On n’arrête pas un massacre de civils avec de l’aide humanitaire »
De nombreux observateurs accusent le gouvernement d’hypocrisie. Loin de l’héritage de Nelson Mandela qui avait fait de la défense des droits humains son principal combat, les présidences successives de Thabo Mbeki, Jacob Zuma et Cyril Ramaphosa ont souvent soutenu des régimes autoritaires. Personne n’a oublié que les autorités sud-africaines ont refusé d’arrêter l’ancien président soudanais Omar al-Bachir, visé par un mandat d’arrêt international, lors de son voyage en Afrique du Sud en 2015. Ni que Cyril Ramaphosa, sous prétexte de médiation, a reçu en janvier 2023 le chef milicien soudanais Mohammed Hamdan Daglo, dit « Hemetti », accusé d’être l’un des artisans des tueries au Darfour et qui se livre avec ses hommes à des exactions dans la bataille pour le pouvoir à Khartoum.
En prenant la tête de l’offensive diplomatique du « Sud global », notamment sur la question israélo-palestinienne, l’ANC espère sans doute faire oublier sa diplomatie à la carte. Décrédibilisé après des années de corruption, le parti veut ainsi redorer son blason en s’appuyant sur son ADN de la lutte. Rien de mieux que de briller sur la scène internationale pour masquer des échecs intérieurs.
Merci pour le share,
je retiens forcement, surtout la conclusion.Faut arreter de se branler avec l’Afrique du Sud, c’est que de la com tout ca au final.
Et puis si on pousse, Nelson Mandela, qu’a t’il change au fond pour les noirs dans ce pays ? Pas mal rien on peut dire.
Les anciens Afrikaaners sont toujours en postes et dominants au final.Je constate aussi qu’il est moins dangereux aujourd’hui de sexprimer sur le conflit Israelo-Palestinien,
Les retournements de vestes dans la societe sont afligeants…Bref,
Desesperée, siderée,Quand on observe tout cela, on sait que rien ne changera au final,
On va juste a la mort en tant que civilisation, c’est tout.Et puis si on pousse, Nelson Mandela, qu’a t’il change au fond pour les noirs dans ce pays ? Pas mal rien on peut dire. Les anciens Afrikaaners sont toujours en postes et dominants au final.
Dire que Mandela ou l’ANC n’a pas changer grand chose à la situation des noirs dans ce pays me semble excessif mais je pense comprendre en partie ce que tu veux dire.
Ça me fait penser aux propos de Peter Gelderloos pour qui (grossièrement résumés ;) ) les mouvements d’émancipation se sont arrêté à mi-chemin à cause de la satisfaction d’importantes avancées qui aurait fait perdre de vue les potentiels vers lesquels tendre tout en s’enlevant les moyens d’y arriver par la mystification entre autres de l’impact de la non-violence et par extension à Malm qui s’intéresse à la manière dont la bourgeoisie européenne a pu s’approprier certaine figures non-violentes en les transformant à leur gout, notamment Mandela dont la radicalité est quelque peu “diminuée”…
Peter Gelderloos et la critique de la non-violence
Dans cet article, je reviens sur le livre de Peter Gelderloos Comment la non-violence protège l’État. J’essaie de montrer que, si sa critique la non-violence est fondée, la position alternative qu’il défend pose certains problèmes. En conséquence, je cherche à proposer quelques pistes de réflexion que nous pourrions explorer pour les résoudre.
https://fr.theanarchistlibrary.org/library/peter-gelderloos-l-echec-de-la-non-violence
Dans les années qui suivirent la fin de la guerre froide, de nombreux mouvements sociaux ont vu le jour. D’abord pacifiques, ils ont ensuite adopté une diversité de tactiques à mesure que leurs forces et leurs expériences collectives prenaient de l’ampleur. Les quinze dernières années ont exposé, plus explicitement que jamais, la fonction de la non-violence.
Promues par les médias, financées par les gouvernements et pilotées par des ONG, des campagnes non violentes, à travers le monde, ont favorisé les ravalements de façade de divers régimes répressifs et permis aux forces de police de restreindre l’extension des mouvements de révolte sociale. Perdant souvent le débat au sein même de ces mouvements, les tenants de la non-violence ont de plus en plus recours aux médias dominants ainsi qu’aux fonds publics et institutionnels pour étouffer les voix discordantes. L’échec de la non-violence explore la plupart des soulèvements sociaux qui suivirent la guerre froide pour faire apparaître les limites de la non-violence et dévoiler ce qu’un mouvement diversifié, indiscipliné et impétueux peut accomplir. En passant au crible le fonctionnement de la diversité des tactiques déployées à ce jour, ce livre explique comment les mouvements en faveur d’un changement social peuvent triompher et ouvrir les espaces dont nous avons besoin pour semer les graines d’un monde nouveau.
Andreas Malm, Comment saboter un pipeline
Spécialiste de géographie environnementale, Andreas Malm s’est longuement intéressé aux sources fossiles du capitalisme1. Ce petit essai interroge les conditions contemporaines de l’action militante, mais il intéressera les historien·nes par ses nombreuses références aux situations passées.
L’auteur s’interroge sur la relative inefficacité politique des luttes en faveur de l’environnement. En dépit d’une situation écologique de plus en plus désastreuse et d’un réchauffement climatique désormais très sensible, les réactions des gouvernants sont minimales et les mouvements environnementaux successifs s’en tiennent à des registres conventionnels d’intervention et de protestation. Andreas Malm s’intéresse tout particulièrement au cas d’Extinction Rebellion, qui organise des manifestations parfois spectaculaires. Il note le refus de l’organisation militante de recourir à la violence et s’interroge sur la portée d’un tel parti pris : « Incontestablement, cette posture l’a bien servi. Elle confère au mouvement beaucoup d’avantages tactiques bien connus. S’il avait déployé d’emblée des tactiques de type black block (…), il n’aurait jamais séduit tout ce monde » (p. 30). Toutefois, la difficulté manifeste à faire entendre le discours en faveur de la défense de l’environnement interroge : « La non-violence absolue serait-elle le seul moyen, restera-t-elle à jamais l’unique tactique dans la lutte pour l’abolition des combustibles fossiles ? » (p. 31).
Ça s’écarte un peu du sujet mais je trouve quand ça aide aussi à exposer l’absurdité des hiérarchies des pseudo-légitimités à l’usage “de la force” et à la barbarie des soutien à Israël…
Les retournements de vestes dans la societe sont afligeants…
Je suis bien d’accord. Est-ce qu’il s’agit toujours de retournement de veste ou parfois de “retour à la raison” tardif qui s’assument à moitié ? Est-ce que même tardifs et/ou avec des arrières pensées, on peut se payer le luxe de ne pas accueillir (se féliciter ?) tous les soutiens possibles pour aider les Palestiniens ?
Oui je me permet de dire les choses comme ca dune car jai pas les ressources ou l’envie surtout, pour pouvoir apporter de l’argumentation comme tas fait. PMU style is mine. Et de deux ouais cest clair que je ne suis pas pas palestinienne.
Dun point de vue palestinien pour le moment il nya pas de petites victoires qui ne compterait pas. Tout est à prendre.
Mais en vrai meme si cest positif meme si tardif et à moitié assumé bah jarrive pas a men satisfaire car oui on s’arrêtera a mi chemin et reviendra en arrière. Mais je m’arrête et devrais lire car la jai peut être besoin de ca aussi. Car du coup oui en vrai on retrouve ca dans tout les sujets. Et je dois reproduire ca ailleurs aussi en vrai. Chacun ses sujets et traumas.
Bon franchement a part dire merci bah je vais pas te contredire, je prend juste ton com en l’État. Ca aide a donner de la perspective. Ouais je rant.